
Le scandale de drogue qui secoue actuellement Nouakchott n’est pas un incident isolé. Il a été aussitôt suivi d’une autre affaire tout aussi grave : l’importation, par des circuits opaques, de médicaments en provenance du Mali — un pays enclavé, affaibli et en pleine crise. Ces événements, loin d’être de simples faits divers, ne sont que les symptômes visibles d’un mal profond et enraciné : un dysfonctionnement systémique alimenté par l’impunité, le népotisme et l’effondrement progressif de l’autorité publique.
Le point de bascule remonte à l’arrivée au pouvoir du colonel Mohamed Ould Abdel Aziz, promu général dans des circonstances troubles. En s’emparant du pouvoir par la force, il a foulé aux pieds les lois de la République et annihilé les acquis démocratiques. Il a ainsi ouvert la voie à une gouvernance autoritaire, prédatrice et clanique.
Les avertissements de ceux qui dénonçaient, à l’époque, les conséquences d’un coup d’État se sont avérées justes : le chaos était déjà en germe.
Durant son règne sans contre-pouvoir, Aziz a désorganisé l’administration, affaibli les institutions, pillé les ressources publiques… avant de quitter le pouvoir sans jamais rendre de comptes — sauf lorsqu’il osa défier celui qu’il avait lui-même désigné comme successeur.
Mohamed Ould Ghazouani, longtemps resté dans l’ombre, n’est pas arrivé au pouvoir par la volonté populaire, mais par la désignation de son prédécesseur. Cette succession — sans légitimité électorale réelle — suscitait dès le départ une méfiance légitime, nourrie par leur longue proximité dans la gestion des affaires de l’État. Dès lors, il n’est pas étonnant que le pouvoir ait poursuivi la même trajectoire de dérive.
Depuis lors, l’État semble gouverné dans l’improvisation permanente, sans cap clair ni vision d’ensemble. Le clientélisme s’est institué en norme, le favoritisme en routine. Les nominations obéissent davantage aux logiques familiales, tribales ou claniques qu’aux critères de compétence ou de mérite. Cousins, beaux-frères, amis et fidèles du cercle rapproché se voient attribuer des postes de responsabilité dans une distribution fondée sur l’affiliation plutôt que sur la qualification. Le Conseil des ministres ressemble à une loterie politique, où chacun espère « être tiré au sort », ou, à défaut, patienter jusqu’au prochain conseil dans l’attente d’un sort plus favorable.
Les scandales se multiplient : détournements de fonds publics, attributions illégales de marchés publics, enrichissements illicites, abus de pouvoir… Et lorsqu’un sursaut d’indignation populaire surgit, il est rapidement étouffé. Les enquêtes s’ouvrent, s’éteignent, puis disparaissent. La justice, quant à elle, ne fait plus illusion : elle mime l’action, mais ne trouble jamais les puissants.
Même le procès de l’ancien président, qui aurait pu incarner un sursaut républicain, a été vidé de toute portée symbolique. Il a surtout permis à Aziz de se poser en victime.
Aujourd’hui, la menace est encore plus préoccupante : celle d’un lien potentiel entre les réseaux de drogue et les mouvances terroristes. Cette hypothèse devient d’autant plus plausible que de nombreuses arrestations concernent des milieux réputés extrémistes. Comme au Mali, au Sahel ou en Afghanistan, l’effondrement de l’État favorise la montée d’économies parallèles où la drogue devient le carburant des guerres.
Ce qui mine la Mauritanie, c’est cette culture du laisser-faire institutionnalisé :
On accède aux responsabilités sans mérite, on s’enrichit sans scrupule, on gouverne sans compétence. Les institutions se délitent, la population désespère, et la criminalité infiltre peu à peu toutes les strates de la société — y compris les plus respectées.
À nos officiers intègres, à notre élite sincère : la Mauritanie est à la croisée des chemins. Deux choix s’offrent à nous : continuer à détourner le regard, dans l’attente illusoire d’un miracle, ou affronter nos démons avec courage, lucidité et détermination.
Il est temps de restaurer l’autorité de l’État, de rebâtir la confiance populaire et d’engager une refondation nationale, profonde, sincère et méthodique.
La phase actuelle de pré-dialogue national ne doit en aucun cas être une manœuvre dilatoire ou une simple opération de communication. Elle doit marquer le début d’une véritable transition, fondée sur des actes forts et des engagements fermes.
Parmi les mesures urgentes à mettre en œuvre :
• Instaurer des nominations fondées exclusivement sur le mérite et la compétence ;
• Révoquer immédiatement les profils compromis ou notoirement incompétents ;
• Lancer un audit financier indépendant, préalable indispensable à toute discussion sérieuse.
Ce n’est qu’à ce prix que la confiance pourra être restaurée.
Si nous avons encore en nous un attachement sincère à l’avenir de notre pays, alors il est plus que jamais temps d’avoir le courage de dire la vérité, de la regarder en face — et surtout, d’agir.
Mohamed Fall Sidatt




.jpeg)



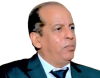








.jpeg)